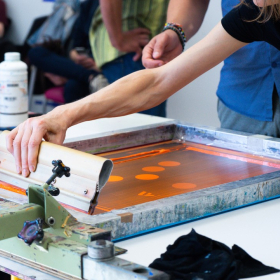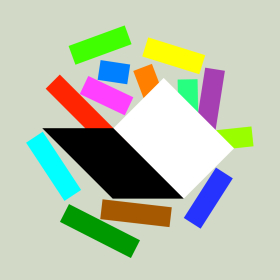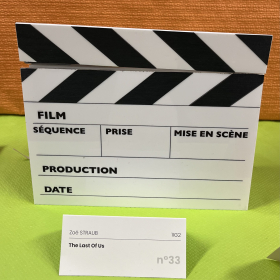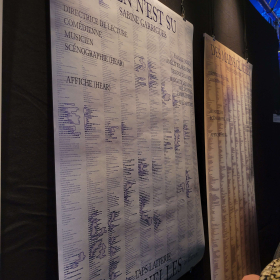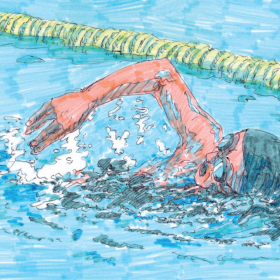Dima Abdallah a rencontré des détenu·es à la Maison d’arrêt de Strasbourg dans le cadre du "Goncourt des détenus". Elle a échangé sur son roman "Mauvaises herbes", l’exil, le Liban, et l’écriture, tout en répondant aux nombreuses questions des participant·es. La rencontre, riche en partages, a également abordé son prochain roman et son lien avec la langue française.
À mon passage, le portique sonne. J’avais passé récemment sans encombre nombre de contrôles de sécurité, mais là, mes semelles se signalent. J’apprends qu’elles contiennent des pièces métalliques, un détail que j’ignorais.
Je rejoins finalement avec retard l’écrivaine Dima Abdallah, Julie Bitz, chargée de mission Capitale mondiale du Livre, et Gilles Hargous, enseignant documentaliste dans l’établissement et promoteur infatigable de la lecture en milieu carcéral. Nous parcourons avec lui le dédale des couloirs et des portes pour arriver dans la petite salle de conférence où se déroulera la rencontre qu’il anime ce matin.
La lecture au cœur de la Maison d’arrêt de Strasbourg
La "prison de l’Elsau", comme l’appellent communément les strasbourgeois·es, est récente. Construite sur un projet de Robert Badinter, la maison d’arrêt de Strasbourg remplace dès 1988 deux anciennes prisons : la dite "Rue du Fil" et la prison Sainte Marguerite, dans l’ancienne Commanderie Saint-Jean qui fût tour à tour un couvent, un hôpital, et qui abritera plus tard l’ENA, proche du nouveau Musée d’Art Moderne.
Ici, à l’Elsau, nous sommes dans des locaux récents, clairs, techniques, mais aussi tellement humains.
Dans cet univers coupé d’internet, où même le personnel doit laisser son téléphone mobile à la porte, on ne compte pas moins de six bibliothèques. Des détenu·es reconnaissables à leur blouse rouge gèrent chacun·e de ces lieux dédiés aux livres.
L’assortiment est particulièrement récent car la maison participe pour la seconde année au récent "Goncourt des détenus".

Des 16 ouvrages sélectionnés cette année et envoyés par le CNIL, le Centre National du Livre, plusieurs sont entre les mains des détenu·es qui arrivent au compte-goutte dans la salle. Quatre femmes et neuf hommes s’installent le long des tables en fer à cheval autour du pupitre de bois duquel Dima Abdallah va commencer à dialoguer avec les participantes et participants. Dima est déjà intervenue plusieurs fois dans des centres de détention et plusieurs membres de l’assistance ont déjà participé à des rencontres avec des auteurs et autrices dans le cadre de programmes de promotion de la lecture en milieu carcéral.
Ce matin, les échanges seront riches et la parole intense.
On y parlera du Liban, de l’exil, de l’écriture, de la langue, des rituels, des maisons d'éditeurs, mais aussi de nos écrivain·es et livres préférés. La conversation roule, fluide, la parole passe des unes aux autres, dans un dialogue qui aurait pu durer plus longtemps encore, tant les participant·es pressent Dima de questions pertinentes.
Entre souvenirs du Liban et écriture autobiographique
L’ouvrage phare examiné aujourd’hui est "Mauvaises herbes", le premier roman de Dima édité en 2020 par Sabine Wespieser, mais on évoquera aussi "Bleu Nuit" paru en 2022, ainsi que le troisième roman de Dima à paraître bientôt.
"Mauvaises herbes" est un roman autobiographique qu’elle ne comptait pas publier.
À l’âge de 18 ans, elle ressent le besoin de rédiger ce compte-rendu d’une expérience, celle de quitter son quotidien de la guerre, son père, son pays natal, sa langue maternelle.
À une question dans la salle : "Dans ce roman, il n’y a pas vraiment de mention de la violence dans le pays ?", Dima répond qu’elle n’avait réalisé la violence de la situation vécue dans son pays d’enfance qu’après l’avoir quitté.
Ce texte autobiographique, elle l’a rédigé comme une réponse aux questions que lui posaient souvent les autres dans ses lieux d’exil sur sa vie précédente au Liban.

"J’ai un lien passionnel avec mon pays et j’ai envie d’y revenir, mais, même en-dehors des événements actuels, c’est une terre fantôme. Je n’ai pas envie d’arriver avec des euros dans un pays en crise. Une telle pauvreté, c’est nouveau au Liban et c’est difficile d’en faire abstraction."
Le Liban actuel l’attire et la repousse
En proie à une grave crise financière, le pays a vu sa monnaie, la livre libanaise, passer en 2023 le seuil fatidique des 100 000 livres pour un seul dollar américain. Là où l’on gagnait autrefois 1500€, on n’en gagne maintenant plus que 100€ et il faudrait des brouettes pour transporter les salaires en livres libanaises. Son économie tient grâce à la diaspora.
À une question sur l’impuissance politique et la corruption des dirigeants au Liban, Dima nous livre son constat :
"Chacun·e est dans son fief, sa matrice, sa communauté, son vortex. Au Liban chacun·e suit son chef aveuglément. Chacun·e a son caïd, même criminel, d’avant la guerre. Les chefs des milices d’il y a quarante ans tiennent. Ils sont increvables. Une étincelle, et c’est la guerre civile. Dans ce pays, chaque fois, on a l’impression qu’on a touché le fond, mais quelque chose de pire arrive après. Je ne sais pas quel miracle peut sauver le Liban".
Elle enchaîne, songeuse : "Pourtant, oui, il y a un autre Liban dans la pensée et le coeur des gens, il y a autre chose qu’à la télé".
Sur l’écriture, les questions des participant·es fusent, cernant le travail de l’écrivaine avec des phrases précises témoignant d’un public rompu aux techniques d’élaboration de l’écrit fictionnel.
L'écriture comme quête de sens
Que vous a apporté l’écriture ?
"Du sens. À propos de son écriture, mon père disait, : « Je vais faire la peau à l’absurde ».
Quelque chose bouillonne en nous, l’écriture est une aventure, un combat, on écrit de l’inattendu. L’écriture, la lecture, c’est donner un peu de sens dans un monde chaotique. J’écris pour donner du sens."
Sur le processus d’écriture :
"Je me restreins à une routine de 2 heures par jour. Pour ma part, écrire c’est 10% d’inspiration et 90% de labeur. C’est important d’écrire en soi, pas d’écrire pour être publiée. J’entends ce que j’écris, l’écriture est un langage, une musique, des rythmes, une forme, pas seulement des personnages et une histoire forte. J’écris d’abord dans ma tête où se forme la langue, puis vient une urgence à coucher cela noir sur blanc. Mais ces deux moments peuvent être séparés par un temps assez long. J’ai d’abord écrit dans ma tête "Bleu Nuit", mon second roman.

Il est né quand je suis allée poster le contrat de mon roman précédent. Son personnage est apparu mais j’ai attendu un an avant d’en faire quelque chose. L’écriture est un processus mystérieux et quand je rends mon manuscrit, je m’en détache, je ne sais pas qui a écrit cela, de quelles abysses c’est sorti."
Avez-vous déjà commencé par la fin ?
"Non, mais j’ai déjà confondu plusieurs fins que j’avais rédigées."
Quand vous vient le titre ?
"Il me vient à la fin."
Quelle méthode utilisez-vous pour écrire ?
"L’ordinateur et le carnet de textes. Mais je me rends compte que j’utilise plus souvent le traitement de texte actuellement, car le déplacement des paragraphes et les modifications sont plus simples. Sur un carnet, les changements sont marqués par des notes qui s’accumulent et rendent le texte plus compliqué à mettre en forme ensuite."
Votre talent est-il dû à vos lectures ?
"Je ne sais pas si j’ai du talent, mais je pense que le talent n’est pas lié à la lecture. On peut faire beaucoup de lectures et être un·e mauvais·e écrivain·e, ou au contraire, lire très peu mais capter les choses, avoir une sensibilité, ressentir les choses autrement. C’est aussi peut-être un héritage."
La souffrance vous pousse-t-elle à écrire ?
"Pas forcément. J’écris ce que je ressens. Il n’est pas forcément nécessaire d’avoir vécu une guerre pour être un bon écrivain."
Routines, influences et amour de la langue française
La conversation porte sur les routines et les rituels des écrivain·es. On cite Paul Auster qui s’astreignait à 8 heures d’écriture par jour. Mais Dima pense qu’il n’y a pas de règles, que ça dépend. Pour certain·es, mieux vaut écrire efficacement pendant 2 heures que de passer 8 heures à une écriture inefficace. Elle, elle fait en fonction de ce qu’elle peut faire au moment donné.
À la question : Le talent est-il développé par la régularité ? Dima répond : "Le plus difficile est d’oser. Je peux barrer tel ou tel paragraphe. Beaucoup de gens prennent la littérature au sérieux et pensent que le 1er paragraphe doit forcément être exceptionnel. Mais il faut de la modestie. Écrire ce n’est pas se mesurer aux monstres de la littérature."
À propos de Maupassant et sa capacité à exprimer des sentiments extraordinaires avec peu de mots, Dima confirme : "Je suis une fan de Maupassant. J’aime aussi particulièrement Camus qui fait des phrases simples qu’on retient. Son écriture est sincère et modeste." À l’objection qu’il a été accusé de faire des phrases plates elle répond : "Elles sont efficaces comme le début de l’Étranger par exemple, qui marque les esprits."
Sur son rapport à la langue française, Dima rappelle que sa langue maternelle est l’arabe. Le français, elle l’a appris à l’âge de 3 ans puis elle a fait sa scolarité dans une école bilingue. Mais par la force des choses et l’exil, elle a été rapidement immergée dans un monde francophone : "Je me sens chez moi, en français. Je suis une amoureuse de la langue française". Elle n’écrit pas en arabe dont elle a perdu l’usage, plus exactement, l’usage de la langue littéraire qu’il faudrait continuer à pratiquer : "J’ai perdu l’arabe littéraire, mais pas le dialecte libanais".
Dans quelle langue parlez-vous à votre mère ? (Rires) "Je parle avec elle dans un cocktail d’arabe et de français !"
Votre fille aimerait-elle retourner au Liban ? "Oui, mais la situation est trop mauvaise actuellement."
À la question : Quelques indices à propos de votre troisième roman ? Dima nous livre quelques confidences que nous garderons pour nous, dans ce cercle improbable qui s’est formé ce matin, lié par un secret commun.